Refus des aides ou professionnels à domicile et maladie d’Alzheimer
REFUS DES AIDES OU PROFESSIONNELS À DOMCILE ET MALADIE D’ALZHEIMER

Accompagner un proche ou un patient vivant avec la maladie d’Alzheimer c’est savoir composer en mode système D en permanence et parfois cela fonctionne et d’autres fois, non.
Refuser, vient du latin « refutare ». Il se définit comme le fait de « ne pas accepter ce qui est proposé, présenté ».C’est très fréquents chez les patients atteints de maladie d’Alzheimer, ou maladies apparentées. Il est parfois le seul moyen pour la personne malade d’exprimer ce dont elle a besoin, envie, ou de montrer son mécontentement.
Le refus peut être exprimé verbalement ou exprimé par des comportements d’opposition, d’agitation, de cris, d’agressivité, etc. Il peut s’exprimer ponctuellement ou de façon répétée. Le refus peut concerner n’importe lequel des soins prodigués à la personne et les conséquences d’un refus sont par conséquent très variables.
Aujourd’hui, nous allons nous pencher sur une situation qui peut un jour vous affecter : que faire si la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer refuse de laisser entrer chez lui un professionnel de santé qui doit effectuer des soins.
Dans un premier temps, nous aborderons le pourquoi on se retrouve en face d’un refus. Puis, dans un second temps, nous poserons les bases de comment faire face à un refus. Et enfin, dans un dernier temps, nous vous donnerons des conseils pour convaincre la personne vivant avec la maladie d’Alzheimer d’accepter les soins.
I -POURQUOI VOTRE PROCHE OU VOTRE PATIENT REFUSE LES SOINS ?
Tout d’abord, bienvenue dans le monde de la contradiction, votre proche en perte d’autonomie veut vivre dans son domicile et en toute autonomie ou de manière autonome en institution, mais il ne veut pas d’aide au quotidien de personnes étrangères, mais pourquoi ?
Plusieurs raisons peuvent expliquer ce refus comme :
– Uniquement parce que l’idée vient de vous
– Il peut être aussi gêné par le fait que vous vous en faites pour lui et par conséquent s’il se débrouille tout seul, c’est qu’il est en bonne santé et autonome. D’ailleurs dans son esprit, c’est à lui de prendre soin de vous et non l’inverse. Il est plus âgé que vous.
– Ensuite, cela peut être aussi le fait qu’on lui impose quelqu’un chez lui ou dans sa chambre alors qu’il n’a rien demandé, car plus son autonomie décline, plus l’aidant ou le professionnel fait à sa place.
– Cela peut aussi cacher une dépression non diagnostiquée. 40 % des seniors retraités ont une relation d’opposition avec leurs proches ou des professionnels.
– Une autre cause possible, c’est la méfiance. Votre proche doit laisser un inconnu entrer dans son intimité parmi sa vie et ses objets de valeur. On lui a inculqué qu’il ne faut pas faire confiance à des inconnus, tout comme à vous.
– Cela peut être aussi le fait que le ménage n’est pas fait ou que votre proche ou votre patient ne puisse pas offrir un café ou une petite collation alors que c’est ce que fait un bon hôte de maison.
– Il peut aussi s’agir également du coût financier de l’aide. Votre proche ou votre patient ne sait pas le coût de cette aide et il a connu la vie difficile : guerre, rationnement, chômage… C’était la vie à la dure, alors peut être que dans son esprit, il vaut mieux faire des économies.
– Et on arrive à la raison la plus simple, mais aussi la plus difficile à admettre : accepter l’évidence de la vieillesse et ne plus être capable de faire les choses comme avant en toute autonomie.

II – COMMENT FAIRE FACE À UN REFUS ?
Il existe 3 clés fondamentales :
- Écouter.
Cela peut paraître idiot, mais créer le dialogue c’est la base. Écouter et faire preuve d’empathie permet de créer de la confiance. Du coup, la personne dans le refus se sent valorisée en tant qu’être humain. Vous devez essayer de trouver un terrain d’entente entre son autonomie et ce que vous aidant, ou le professionnel pouvez faire pour l’aider. Soyez bienveillant(e)
Remarque : Dire à une personne en perte d’autonomie qu’elle a le droit de refuser de l’aide, peut aussi parfois la bloquer pour en demander par la suite. Essayez de bien choisir vos mots.
- S’adapter.
Voilà peut être ce qu’il y a de plus dur à faire. Il va falloir que l’aidant ou le professionnel agisse en souplesse et soit capable de s’adapter à la personne et son rythme de refus. Il va falloir déjà établir de la confiance, puis ensuite trouver des compromis en respectant les habitudes de vie de la personne à aider, sans la critiquer, mais plutôt en essayant de faire évoluer sa décision par étapes vers une acceptation.
- Coordonner
Deuxième petit écueil à combattre, il va falloir que tout le monde, aidant comme professionnel se coordonne. Du coup, pour être efficace, il conviendra de : partager les informations, partager les décisions, se soutenir mutuellement, être cohérent dans les interventions. Cela permettra une harmonisation des soins et donc aussi moins de comportement perturbateurs. NB : n’oubliez pas d’inclure la personne à aider. Vous aurez peut-être la réponse de son refus.
Comment faire face à un refus si vous êtes un aidant ou un professionnel ?
Dédramatiser
Sauf en cas d’urgence vitale, ce qui est rarement le cas, pas de risque d’être accusé de non assistance à personne en danger.
Relativiser
Référez-vous aux habitudes de vie de la personne âgée et non à ce que vous estimez bien pour elle (exemple : ne pas se laver tous les jours n’est pas une catastrophe, ne pas faire trois repas par jour non plus, ni se raser ou se couper les ongles toutes les semaines)
S’organiser
Garder une trace écrite des contacts avec la personne âgée. Refaites le point au moins tous les six mois, bien que tous les deux mois soit préférable. Ainsi vous pourrez regarder ce qui a été mis en place a fonctionné ou pas et quelles nouvelles pistes vous pourrez adopter par la suite. Votre patience est un atout.
III- CONSEILS POUR CONVAINCRE LA PERSONNE VIVANT AVEC LA MALADIE D’ALZHEIMER D’ACCEPTER LES SOINS
– Adopter un discours unique. Il est essentiel que tous les intervenants aient le même discours. Si par exemple, votre proche a l’habitude de son café avant sa douche et bien, il faudra que les intervenants extérieurs soient d’accord avec lui. C’est à vous aidant ou professionnel de vous adapter et pas l’inverse. Si ce n’est pas possible, parlez-en avec lui, ainsi il se braquera moins.
– Trouver le bon intervenant. Dans une situation de refus, il est impératif de trouver l’intervenant qui saura rétablir la relation avec la personne âgée.
Par exemple, pour ma mère, j’ai toujours été présente lors de sa première rencontre avec les différents intervenants et la seule fois où je n’étais pas là, elle a refusé de lui ouvrir sa porte.
– Respecter ses choix. Ne faites pas de forcing, la personne qui doit être aidée, doit se sentir libre de ses choix. De plus, le professionnel doit respecter au maximum la culture et les habitudes de vie. En cas de manque de temps trouver un compromis. Par exemple : 1 douche par semaine avec lavage des cheveux, et toujours le même jour.
– Discuter calmement. Ne pas s’énerver en cas de refus, car cela le mettra en colère, car après tout c’est lui votre ainé donc c’est à vous d’obéir surtout si vous êtes son enfant.
– Expliquez-lui pourquoi c’est important pour vous. Cela peut être le fait que vous serez plus serein, ou aurez plus de temps libre pour vous promener avec lui, ou qu’il doit avoir de la visite….
– Expliquez-lui pourquoi c’est bon pour lui. Il sera plus présentable et beau ou belle à vos yeux, il ou elle sera moins fatigué(e), vous pourrez ensuite faire des activités ensemble.
Remarque : L’important est de faire comprendre à votre proche qu’avoir une aide extérieure ne signifie pas que vous ne l’aimez plus ou ne voulez plus passer du temps chez lui ou avec lui
– Donnez-lui ou regarder les brochures d’aide ensemble. Ainsi, il s’inquiétera moins pour le coût de cette aide et il pourra choisir les jours de passages. Essayez de rencontrer avec lui ou elle les différents intervenants.
– Faites un essai. Dites à votre proche que s’il veut s’arrêter, il le peut. Veillez quand même à lui laisser le temps de s’habituer, car sinon vous risquez d’entendre dès le départ : je veux être tout seul chez moi ou dans ma chambre, on arrête tout. Gardez à l’esprit que les intervenants vont bouleversés sa routine quotidienne.
– Place au propre. Si c’est la maison en désordre qui dérange votre proche, faites place au grand ménage et pourquoi pas en famille avec les petits enfants et vous finirez avec un bon gâteau maison. Ps : n’oubliez pas le paquet de biscuits éventuel pour l’offre du petit thé ou café. Rangez-le ensemble toujours au même endroit. Pensez à mettre un repère visuel sur le placard.
– Demandez au médecin traitant. Parfois la parole du médecin traitant c’est une parole d’évangile. Beaucoup d’aînés sont intimidés par le côté blouse blanche et si c’est le docteur qui dit que l’aide est bonne pour sa santé, votre proche peut accepter l’idée plus facilement.
– Donner du travail. Autre méthode qui fonctionne bien, vous pouvez dire à votre proche qu’en acceptant l’aide de l’intervenant cela lui donne un travail et que c’est important, car le taux de chômage est très fort. De plus, dans cette astuce ce n’est plus vraiment votre proche qui est aidé, mais c’est lui qui aide l’autre et donc il contribue à la communauté, c’est valorisant
Alzy récapitule pour vous :
– La maladie d’Alzheimer entraîne souvent de l’opposition au soin
– Il convient de s’adapter et de faire en sorte que tous les intervenants collaborent et se coordonnent pour éviter l’opposition au soin
– N’hésitez pas à faire des traces écrites des refus, essayer de comprendre causes et surtout discuter avec empathie avec la personne ayant des troubles cognitifs.
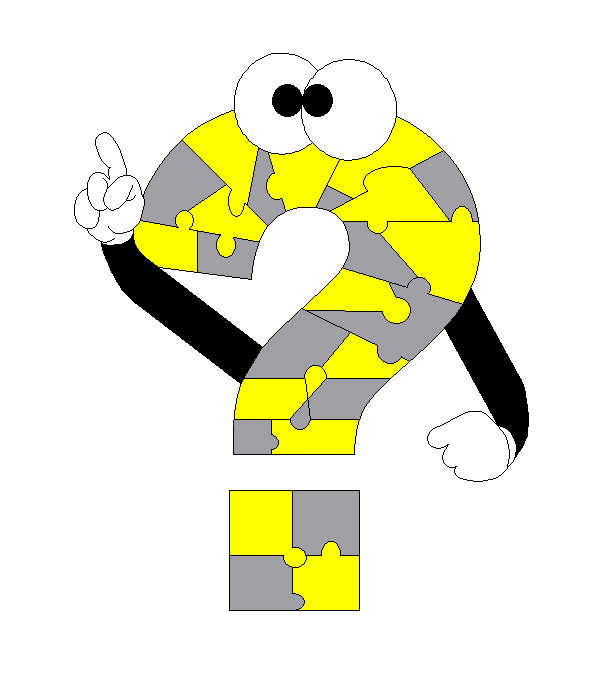











Commentaires récents